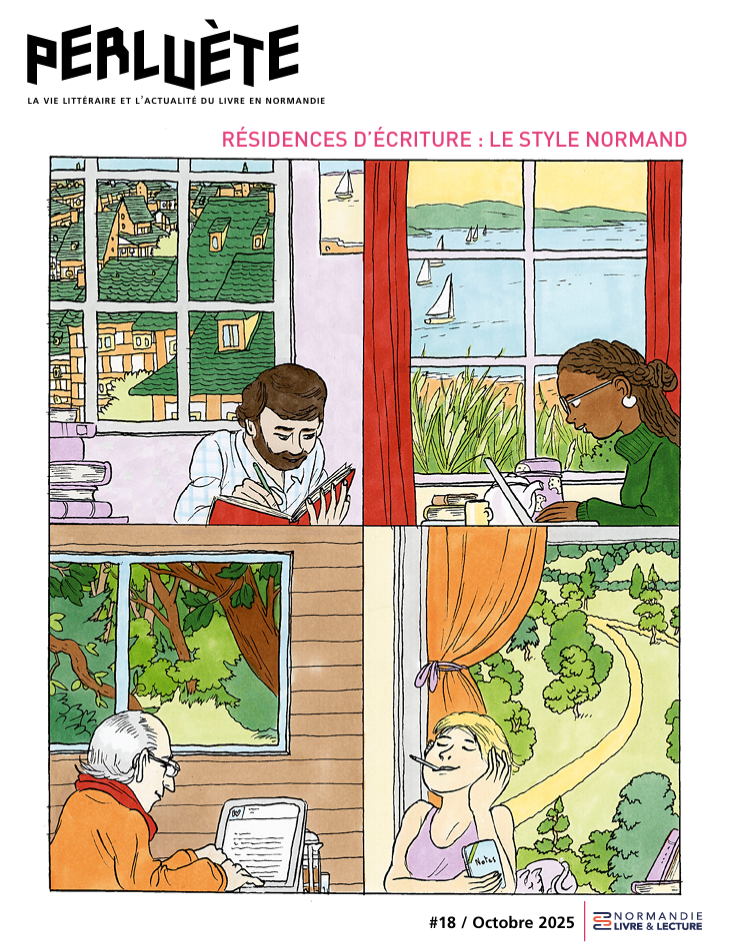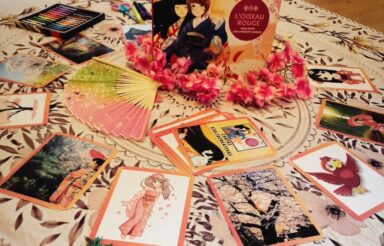Pour une égalité de genre dans la culture
Pourquoi une approche sociologique ? La culture a-t-elle vraiment des soucis avec le genre ? Et au fait, épicène ça veut dire quoi ? 3 questions posées à Élise Devieilhe.

La formation questionne l’égalité de genre avec un regard sociologique. En quoi cette approche est-elle importante ?
L’égalité de genre, ou plutôt les inégalités de genre, sont des questions très travaillées en sociologie. La perspective sociologique permet de mieux comprendre le contexte dans lequel s’expriment ces inégalités, par exemple les violences sexistes et sexuelles.
Adopter un regard sociologique sur le genre, c’est d’une part, dénaturaliser ce qu’on appelle « la masculinité » et « la féminité » : non, il n’y a pas de nature préétablie, éternelle et immuable, qui feraient des hommes des brutes épaisses qui cherchent à dominer, et des femmes des êtres fragiles et inférieurs. Nous devenons ce que la société fait de nous, des femmes et des hommes avec une binarité et des rôles stéréotypés qui nous ont été transmis dans notre éducation et notre culture. La sociologie du genre permet donc de remettre en question cet ordre inégalitaire, en soulignant que le changement social vers plus d’égalité est possible, si l’on fournit un effort collectif dans ce sens.
D’autre part, la sociologie du genre permet de mettre en évidence les structures (généralement cachées) qui sous-tendent ces inégalités : notre société est structurée par des rapports de pouvoir et de domination, qui font que les inégalités et les violences ne sont pas simplement le fait de personnes mal intentionnées qui chercheraient à écraser individuellement les autres : la société place les hommes qu’ils le veuillent ou non, dans une situation de domination dont ils bénéficient, même s’ils ne sont pas individuellement violents ou machistes. D’ailleurs, la violence de certains hommes profite justement aux hommes non-violents, qui passent pour « des hommes formidables » alors qu’ils s’abstiennent juste de violenter.
C’est ce raisonnement de déconstruction des évidences et d’approche structuraliste qui est intéressante dans l’approche sociologique de l’égalité de genre.
Le secteur de la culture n’est pas exempt de ces problématiques. Y a-t-il quelques chiffres notables pour comprendre le secteur culturel normand sur ces questions ?
En effet, le secteur culturel jouit d’une réputation plutôt progressiste, favorable à l’égalité et à l’ouverture… peut-être même féministe. Pourtant, en 2006, la publication du rapport de Reine Prat sur l’égalité femmes-hommes dans la culture, est un électrochoc. Le monde de la culture, qui se pensait socialement en avance, se découvre parfois moins paritaire que… l’armée. Les recherches sur les inégalités de genre dans la culture ont démontré que dans les secteurs du patrimoine, de la création, de l’édition, de l’industrie culturelle, il existe un ensemble d’obstacles aux carrières des femmes, et des structures patriarcales qui perdurent et permettent notamment la prolifération des violences sexistes et sexuelles.
Malheureusement (mais sans surprise), le secteur culturel normand n’est pas épargné : c’est l’association HF+ Normandie qui a cartographié et mesuré les inégalités de genre dans les structures culturelles de Normandie, et publié un Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture en Normandie (Édition 2024 – Données 2022). Le constat est amer :
- une sous-représentation des femmes dans les postes de direction de structures (36% de femmes), et à la programmation (27,5% de femmes). Seuls 31% des postes de direction artistique sont occupés par des femmes.
- une répartition très genrée et stéréotypée des postes : les femmes sont très présentes dans la culture dans l’administration, la production, l’accueil, la communication… Les hommes occupent 90% des postes techniques.
- un sous-financement des artistes femmes et des œuvres créées par des femmes. Les femmes sont aussi moins programmées et moins exposées que les hommes. En conséquence, de grandes inégalités économiques au détriment des femmes sont observées en Normandie comme ailleurs.
L’association via laquelle tu proposes cette formation s’appelle Épicène. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire et pourquoi ce nom résonne fortement avec la formation ?
Épicène est un terme de grammaire, il désigne les mots qui n’ont pas besoin d’accord au masculin ou au féminin (« dont la forme ne varie pas selon le genre »). Par exemple, « Camille » est un prénom épicène. « Camarade », « sympathique » sont des mots épicènes. Pour nous, le terme épicène soulignait à la fois le caractère socialement construit et arbitraire des conventions sociales de genre (qui a décidé qu’on dirait en français « un bureau » mais « une table » ? Qui a décidé que « le masculin l’emporterait sur le féminin » ? Ce sont des décisions tout aussi arbitraires que de décréter que les hommes doivent porter des pantalons et les femmes des jupes…) Et surtout, « épicène » mettait en lumière la possibilité d’une émancipation du genre. Oui, la langue française est très genrée, mais si on y réfléchit collectivement, on peut la rendre plus inclusive pour tout le monde. De la même manière, Oui, la société française est structurée par les inégalités et les violences de genre, mais on peut collectivement faire évoluer cette situation en remettant en question les normes établies. C’est, je l’espère, le message principal qui ressort des formations que l’on anime avec Épicène : il n’y a pas de fatalité aux inégalités. Le changement social est possible et souhaitable, alors au boulot !
Propos recueillis par Marion Cazy
Pour en savoir plus : www.epicene.fr